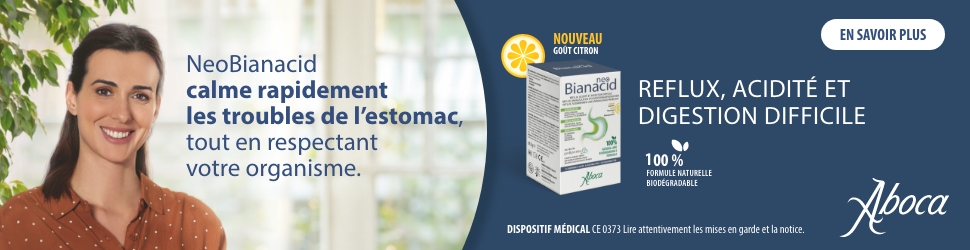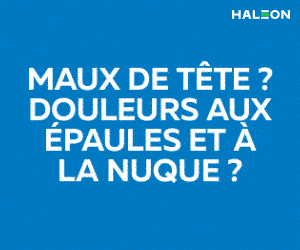Septembre, le mois de l’acné ?
L’expérience clinique montre que le soleil améliore les lésions d’acné notamment au niveau du dos. Mais il induit aussi un épaississement de la cornée souvent à l’origine d’un rebond de la pathologie à la rentrée.

L’acné vulgaire reste la dermatose inflammatoire la plus courante traitée dans le monde. 80 à 90 % des adolescents en souffrent et, pour 60 à 70 % d’entre eux, un traitement médical est nécessaire. Chez l’adolescent, c’est surtout le facteur hormonal qui est en cause. Le tabac et le cannabis sont également des facteurs favorisants, ceci s’explique par la présence de récepteurs nicotiniques et cannabinoïdes au niveau de la peau.
Sans oublier l’acné cosmétique consécutive à l’utilisation de produits trop gras, occlusifs, non adaptés au type de peau, qui favorisent l’apparition et constituent un facteur d’aggravation de l’acné dans les zones traitées.
La génétique et la pollution jouent à leur tour un rôle, de même que le stress. Celui-ci stimule les glandes surrénales, ce qui explique par exemple pourquoi des poussées d’acné s’observent au moment des examens…
Le rôle de l’alimentation fait également débat, notamment le lien entre l’acné et le chocolat, le lait, ou encore les sucres rapides.
Loin du soleil
Quant à l’exposition au soleil, elle peut entraîner une poussée. Au point que pour certains dermatologues, le mois de septembre est celui de l’acné, tant ils observent sa réapparition à chaque rentrée. Il s’agit d’une constatation clinique, il n’existe pas de donnée scientifique nouvelle confirmant ou infirmant le rôle du soleil, constate par ailleurs la Société française de dermatologie.[1]
Cette dernière conseille néanmoins aux patients acnéiques d’éviter le soleil : « L’amélioration immédiate après exposition solaire par assèchement des lésions inflammatoires dans un premier temps ne dure pas. En effet, il se produit un épaississement secondaire de la peau qui va aggraver les lésions rétentionnelles (comédons). Après arrêt de l’exposition solaire, l’acné va rebondir et s’aggraver. De plus, l’exposition solaire peut parfois faire pigmenter (brunir) les cicatrices. Enfin, la prise de certains médicaments (cyclines, isotrétinoïne…) doit faire éviter le soleil. »
Enfin, les rayons du soleil ralentissent également la prolifération de la bactérie Cutibacterium acnes (C. acnes; anciennement Propionibacterium acnes) (lire ci-contre), responsable de la forme inflammatoire de l’acné.
Prévention de tous les jours
C’est l’occasion de rappeler les règles de base pour prévenir l’acné. La première passe par le respect de l’hygiène avec des produits adaptés et par la protection solaire avec des crèmes pour peaux acnéiques en cas d’exposition au soleil.
L’hygiène de base est un incontournable : nettoyage du visage avec une lotion micellaire ou un gel nettoyant « peau acnéique » ou un pain sans savon, crème hydratante, éventuellement matifiante… Tous ces produits doivent être adaptés aux peaux acnéiques, c’est-à-dire non comédogènes ou pour peau mixte à grasse.
Il faut sensibiliser les jeunes et les inciter à prendre soin de leur peau matin et soir, en évitant les gommage et les masques trop agressifs pour la peau.
Martine Versonne
Une question de microbiotes
On parle de plus en plus de la dysbiose du microbiote cutané dans l’acné commune. Si la physiopathologie de l’acné est complexe, il semble que l’interaction entre les microbes cutanés et le système immunitaire de l’hôte joue un rôle important dans cette maladie, avec une composition et une activité microbiennes perturbées chez les patients atteints d’acné.
La bactérie Cutibacterium acnes est couramment présente dans les zones riches en sébum et sa prolifération excessive est depuis longtemps considérée comme contribuant à la maladie. Il est intéressant de noter que la recherche sur le microbiote a montré que l’acné est liée à la virulence de la souche de C.acnes plutôt qu’à la quantité totale de cette bactérie.
En cas d’acné, certains types de C.acnes disparaissent tandis que d’autres deviennent prédominants. Cette perte de diversité est un premier élément en faveur de la dysbiose. En parallèle, d’autres bactéries de la famille des staphylocoques (principalement S.epidermidis et S.aureus) prolifèrent et accentuent le déséquilibre du microbiote.
L’acné a également des liens étroits avec le tractus gastro-intestinal, et nombreux sont ceux qui affirment que le microbiote intestinal pourrait être impliqué dans le processus pathogène de l’acné. On suppose par exemple que les émotions liées au stress (dépression et anxiété, par exemple) aggravent l’acné en modifiant le microbiote intestinal et en augmentant la perméabilité intestinale, ce qui pourrait contribuer à l’inflammation cutanée.
Au fil des ans, un nombre croissant de recherches ont mis en évidence l’existence d’un axe intestin-cerveau-peau qui relie les microbes intestinaux, les probiotiques oraux et l’alimentation, un domaine qui fait actuellement l’objet d’une attention particulière.
M.V.
mLife 2023;2(2):107-120 ; J Clin Med 2019;8(7):987